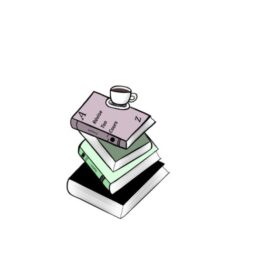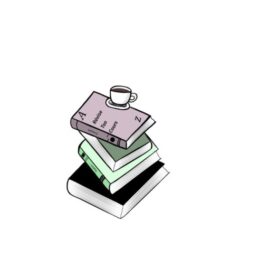Les Cahiers de Douai de Rimbaud

Arthur Rimbaud restera pour toujours dans les mémoires comme un auteur révolté, plein de fougue aux allures presque mystique, avec ce don de voyance qui lui fera écrire des poèmes inégalables. Dans Illuminations et Une saison en enfer, il est déjà un poète aguerri. Cependant, il n’en est pas de même dans les Cahier de Douai, où l’on sent une tension entre l’auteur en devenir et le jeune garçon qui cherche à se faire publier, dans les pas de ses prédécesseurs.
Contexte autour de la création littéraire des premiers poèmes d’Arthur Rimbaud
Avant toute chose, il faut avoir en tête que les Cahiers de Douai portent plusieurs noms selon les éditions et les époques. Il peut aussi s’appeler ainsi que Recueil Demeny, reprenant ainsi le nom du destinataire des poèmes : Paul Demeny. Il se compose de 22 poèmes divisés en deux cahiers. Le premier comporte 15 poèmes et le second 7.
Les Cahiers de Douai marquent les débuts en poésie de Rimbaud
Rimbaud est très jeune, 16 ans, lorsqu’il commence à écrire les poèmes, entre mars et octobre 1870, qui composeront cet ouvrage en deux cahiers. Il souhaite être édité et pour cela il se lance dans la rédaction d’un recueil, comme les grands poètes de l’époque. Il en est à ses prémices en tant qu’auteur avec cet ouvrage et son écriture est encore fragile. D’ailleurs, il écrit les deux cahiers lors de deux fugues chez son maître rhétoriqueur Georges Izambard.
Il n’est pas encore le grand Arthur Rimbaud reconnu grâce à ses Illuminations. On ne sait d’ailleurs pas bien s’il cherchait à être publié en passant par Paul Demeny, à qui il confie ses poèmes, ou si cette décision venait d’un simple partage ou de l’envie d’être lu par un confrère. D’ailleurs, à peine un mois après avoir confié ses liasses, il demande à son ami de brûler son ouvrage, comprenant déjà que ce qu’il a écrit est dépassé et constatant qu’il a progressé :
Vous respecterez ma volonté comme celle d'un mort, brûlez tous les vers que je fus assez sot pour vous donner lors de mon séjour à Douai.

Arthur Rimbaud et Paul Demeny : rencontre de deux jeunes poètes
Les poèmes qui composent l’ensemble des poésies de Douai nous parviennent de manière difficile, après avoir été détenus par plusieurs possesseurs. Nous avons appris, à travers une lettre de Rimbaud, que la liasse de poèmes désorganisée était destinée à Paul Demeny, qui en a longtemps été l’acquéreur. Ils ont été envoyés à ce dernier alors qu’Arthur voulait lui dire au revoir, avant de rentrer chez lui. Quelque temps plus tard, le jeune poète demande expressément à son ami de brûler son ouvrage, ce qu’il n’a pas fait puisque nous les lisons aujourd’hui…
En effet, Paul Demeny ne fait pas grand-chose des vers de son ami. S’il ne respecte pas le souhait de Rimbaud en conservant les poèmes, il ne tente pas non plus de les faire lire ou publier. Il se contente probablement de les garder dans un coin de son domicile et c’est bien après la mort de Rimbaud que le recueil sera publié, en 1891, soit 21 ans après l’écriture de l’ouvrage. En effet, l’ouvrage sera vendu à plusieurs reprises et passera entre de nombreuses mains avant d’être édité en 1891.
Alors qui est ce Paul Demeny ? Il s’agit d’un jeune poète également. Il est connu par Arthur Rimbaud pour avoir écrit Les Glaneuses et être parvenu à se faire publier par un éditeur parisien. Cela intrigue notre auteur qui cherche lui aussi à se faire publier, ce qu’il mentionne très clairement dans sa correspondance avec Demeny. On ne sait pas tellement s’il y a une véritable amitié ou s’il s’agit plutôt d’une forme de relation de "travail" ou d’admiration, mais elle nous permettra de lire aujourd’hui les prémices de l’écriture d’Arthur Rimbaud.
Une soif de liberté insatiable comme mode de vie
En effet, il fugue souvent et cherche à tout prix à être libre de ses mouvements. Cela vient probablement d’une lutte avec l’autorité familiale, puisque sa mère est très sévère. Il se rebelle également très vite contre l’autorité religieuse qui représente elle aussi l’ordre familial et une quête éducative qui enferme plus qu’elle ne libère.
Le Cahier de Douai à l’image de sa vie : une itinérance à enlacer
Alors il vit comme il l’entend et au fur et à mesure que sa plume se précise, il se libère de toutes les normes sociales, de la guerre, des formes d’autorités qui s’abattent sur lui (politique, religieuse, familiales) et il cherche l’aventure partout où elle se trouve. Il ne s’arrêtera jamais vraiment, bien que le génie littéraire qui le touche semble se murer dans le silence arrivé à l’âge adulte. En effet, la liberté que recherche Rimbaud semble être à la fois dans la révolte et dans le mouvement.
Cette soif de liberté se lit déjà dans Les Cahiers de Douai où il définit son besoin de faire partie de la Nature et non plus d’un groupe social avec la pression qui l’accompagne. Il nous offre un aperçu d’un amour plus grand et plus libre, qui ne peut se faire que dans le monde naturel ("Sensations") :
Je ne parlerai pas, je ne penserai rien :
Mais l’amour infini me montera dans l’âme,
Et j’irai loin, bien loin, comme un bohémien,
Par la Nature, — heureux comme avec une femme
Le second cahier, entre expérience et début du véritable voyage poétique
Notons toutefois que s’il parle dans "Sensation" (premier cahier) au futur de cette quête de liberté, il semble avoir un nouveau regard sur cette expérience dans le second cahier avec "Ma Bohème". En effet, il parle alors à nouveau de cette figure de la bohème, mais cette fois au passé et avec une certaine forme d’attendrissement :
Oh ! là là ! que d’amours splendides j’ai rêvées !
Mais il en ressort grandit et différent puisqu’il a fait l’expérience des itinérances et de la souffrance et la pauvreté qu’elle entraîne. Cependant, cela nourrit sa poésie qui sera plus souple et dénuée de l’innocence et du rêve. Sa plume sera "élastique", plus souple et piquant.
Mon unique culotte avait un large trou.
— Petit Poucet rêveur, j’égrenais dans ma course
Des rimes. Mon auberge était à la Grande-Ourse ;
— Mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frou.
Où, rimant au milieu des ombres fantastiques,
Comme des lyres, je tirais les élastiques
De mes souliers blessés, un pied près de mon cœur !
Le recueil de Demeny montre un fort besoin d’émancipation et de révolte
Comme homme libre, il souhaite naturellement se rebeller également contre les clichés qui s’installent naturellement dans la société. Mais il va aussi défendre la vie des hommes et leurs droits en se rebellant contre les lubies monarchiques menant à la guerre et à l’appauvrissement de la société.
Se moquer pour mieux montrer ?
La liberté qu’Arthur Rimbaud recherche est aussi sociale, politique et religieuse. Il ne se prive pas de la faire savoir dans les deux cahiers qui composent l’ouvrage. En effet, que ce soit encore dans "Le Forgeron", "Au cabaret vert", dans "Première soirée", "Le Châtiment de Tartufe", etc., il se moque et critique ouvertement toute forme de pouvoir.
D’abord, il se moque de la bourgeoisie et de leur hypocrisie, que ce soit les jeunes filles qui ne connaissent pas plus loin que leurs allées et pensent vivre une aventure en sentant seulement des fleurs ("Roman"). Il se moque aussi de l’ordre social et de toute la société de manière générale, stéréotypée. Dans "À la musique", il décrit par exemple "Tous les bourgeois poussifs qu'étranglent les chaleurs / Portent, les jeudis soirs, leurs bêtises jalouses."
Il n’est pas toujours question de se moquer cependant, puisque le poète s’arrête de nombreuses fois sur la misère des hommes. Dans "Les Effarés" par exemple, les enfants offrent un tableau innocent de gourmandise, mais dont la fin sonne autrement, puisque nous réalisons que les "petits" sont en réalité affamés. Aussi, "Le forgeron" est un bel exemple de ce contraste qu’offre Rimbaud à propos des bourgeois et des pauvres :
Oh ! tous les Malheureux, tous ceux dont le dos brûle
Sous le soleil féroce, et qui vont, et qui vont,
Et dans ce travail-là sentent crever leur front
Chapeau bas, mes bourgeois ! Oh ! ceux-là, sont les Hommes !
Finalement, c’est dans la caricature qu’il parvient à exprimer le mieux sa révolte et son mépris face aux bourgeois et bonapartistes. Son irrévérence reste d’autant plus perceptible qu’il ne se contente pas de critiquer les riches, il défend les pauvres en offrant, cette fois-ci, une image de la pauvreté et de la souffrance qu’ils endurent. Il érige également des modèles des luttes, les Crapules telles que le forgeron, à l’image des communards pour qui son cœur semblait battre et sa plume se lever dans sa propre poésie.
Lutter contre les pouvoirs religieux et les croyances détournées
S’il dénonce la pauvreté et les comportements des bourgeois, il dénonce également l’hypocrisie politique et religieuse. D’abord, il rejette l’idée du divin et tourne au ridicule aussi bien le monde catholique dans "Le mal", "Le châtiment de Tartufe", "Vénus anadyomène", "Les premières communions", etc. Dans "Le mal" par exemple, il va montrer combien la religion ne représente pas toujours les préceptes qu’elle dispense :
— Il est un Dieu, qui rit aux nappes damassées [...]
Et se réveille, quand des mères, ramassées
Dans l’angoisse, et pleurant sous leur vieux bonnet noir,
Lui donnent un gros sou lié dans leur mouchoir !
En effet, le poème nous place face à un roi et des hommes qui ricanent et un ciel bleu, alors qu’ils assistent à une scène sanglante de guerre où le sang et la mort dominent. Eux se trouvent en revanche dans l’opulence. Rappelons que le roi est obligatoirement choisi par Dieu et qu’il le représente. La figure religieuse semble ainsi se moquer de la perte et de la souffrance, mais il refait surface lorsqu’il est question d’argent et de femmes éplorées. Il relève cette hypocrisie religieuse, corrompue par l’argent (cf. "Le Forgeron") alors qu’il se veut antimatérialiste.
Dans "Soleil et chair" encore, il détourne le credo chrétien en "credo in unam" qui va plutôt mettre en avant une figure de déesse de l’amour ; où la sexualité est permise. Ce n’est évidemment pas le cas à cette époque dans la religion chrétienne pour les hommes d’Église, alors que Rimbaud considère que cela fait partie des expériences d’adolescence, celles qui mènent vers la liberté des corps et l’âge adulte. De façon générale, il rejette alors la religion, car elle déporte les sentiments vrais vers un être mystique, qui est indifférent à l’homme. La religion représente aussi en un sens l’éducation qu’il a reçue par sa mère dans toutes ses règles et son autorité qu’il n’accepte pas.

Révolte contre la monarchie et l’empire
Le contexte politique appuie sur ce besoin de se révolter, puisque la guerre franco-prussienne de 1870 fait des ravages et crée une instabilité politique qui accentue son désir de rompre avec une bourgeoisie qui ne prend pas soin de la vie d’autrui. C’est aussi contre toute la monarchie absolue et particulièrement contre Napoléon III qu’il se soulève. En effet, toutes ces guerres sont dues à la soif de conquête d’un seul homme, qui tente de se faire passer pour glorieux pour peu.
"L’éclatante victoire de Sarrebrück"
C’est le cas par exemple dans "L’éclatante victoire de Sarrebrück". En quelques mots, la victoire de Sarrebrück n’a rien d’éclatante puisqu’il s’agissait simplement d’un petit accrochage entre l’armée prussienne et française. Cette petite bataille n’apporte en effet aucune gloire militaire, mais l’Empire s’empresse de la faire connaître et la portée en grande conquête pour redorer le blason de la France.
Dans ce poème satirique, il n’hésite pas à faire de cette grande victoire quelque chose d’antithétique ("Féroce comme Zeus et doux comme un papa") et de ridicule, avec toutes les couleurs et les extravagances des personnes mentionnées. Il donne le sentiment qu’il s’agit d’un jeu, un carnaval où le vulgaire a plus sa place que la grandeur. Il termine même sur une grossièreté argotique lorsqu’il présente Boquillon, personne emblématique et soldat à l’époque, montrant son derrière et disant "de quoi ?".
Présenter l’Empereur comme un être chétif, au même titre que son Empire
Il ne laisse rien passer à Napoléon III, à son Empire et la monarchie également. En effet, il sera particulièrement virulent envers l’Empereur dans "Rages de Césars". Ce poème sonne la défaite de Sedan, mettant fin à la guerre franco-prussienne à l’avantage de ces derniers. Napoléon, fait prisonnier dans le château de Wilhelmshobe, est présenté par Rimbaud comme une personne à la fois rageuse et fade. Son enfermement permet de voir ce qu’il reste de l’homme hors de ses convictions militaires et il est en réalité plutôt terne et faible, obligé de renoncer à ses grandeurs espérées. Au-delà de la critique de l’Empereur dans ce poème, Rimbaud fait gagner la liberté, qui l’emporte sur les vanités des hommes.
Dernier exemple, dans "Le Forgeron", le poète propose l’image d’un "Roi pâle, suant qui chancelle debout". Cela nous renvoie l’image d’un roi chétif et mal à l’aise, avec les codes de la beauté de la pâleur. Il s’oppose alors de toutes ses forces au forgeron, fort et suant sous l’effort et la chaleur du feu, brûlant de vie et de liberté. Celui qui est présenté comme un petit voyou est encore celui qui est le plus ardent de vie et de justice alors qu’en face de lui, le roi qui représente la justice offre plutôt l’image d’un régime monarchique malade et inadapté. La crapule, du point de vue du pouvoir, ne l’est alors que par l’incompétence du pouvoir.
Ne nous y trompons pas alors. En effet, si Rimbaud parle de la monarchie et d’un roi, c’est également pour éviter la censure puisque la France est un Empire sous Napoléon III. Cependant, les deux régimes se confondent assez et s’opposent à ce que rêve Rimbaud : une République qui offrirait plus de liberté au peuple. Enfin, il ridiculise Napoléon III mais à travers lui, ce sont toutes les figures d’autorité de son acabit qu’il vise.
Dénoncer la guerre et ses ravages
De nombreux poèmes traitent du sujet de la guerre, parmi lesquels "Le Dormeur du Val" qui reste probablement l’un des plus connus de l’auteur. S’il dénonce ardemment les guerres et les rêves de conquête, il trouve tout de même que certaines guerres sont justes, notamment celles qui aspirent à la liberté. C’est bien pourquoi il admire autant les communards. Il rend également aux soldats leur image valeureuse, qu’ils n’ont pas démérité. Il n’hésite pas non plus à les ériger en tant que martyrs dans "Morts de 92" où l’on peut lire :
Vous dont le sang lavait toute grandeur salie
Morts de Valmy, Morts de Fleurus, Morts d’Italie
Ô million de Christs aux yeux sombres et doux ;
En faisant référence à plusieurs combats armés qu’il considère comme juste, il présente ceux tombés au combat comme des Christs, utilisant cette fois l’imagerie de la religion comme une chose digne. En effet, ces soldats se sont sacrifiés pour le bien commun, à l’image qu’il se fait d’une religion juste et originelle. Rappelons qu’avant de s’en prendre à la religion, ce sont les religieux que Rimbaud critique.
Malgré quelques guerres "nécessaires" pour la liberté, il en est aussi qui sont de l’ordre de la vanité, comme celles menées par Napoléon III que Rimbaud s’empresse alors de critiquer. Deux clans s’opposent alors : il y a le "nous" face au "vous" dans ce même poème, pointant le conflit entre ceux qui aspirent à une République et se battent pour et ceux qui se soumettent à l’Empire. Rimbaud éprouve tout de même une certaine tendresse pour ceux qui tombent au combat, oubliés bien vite au profit d’un titre de victoire ou de défaite. Il les plaint aussi bien dans "Le mal" que dans "Le dormeur du Val" par exemple.
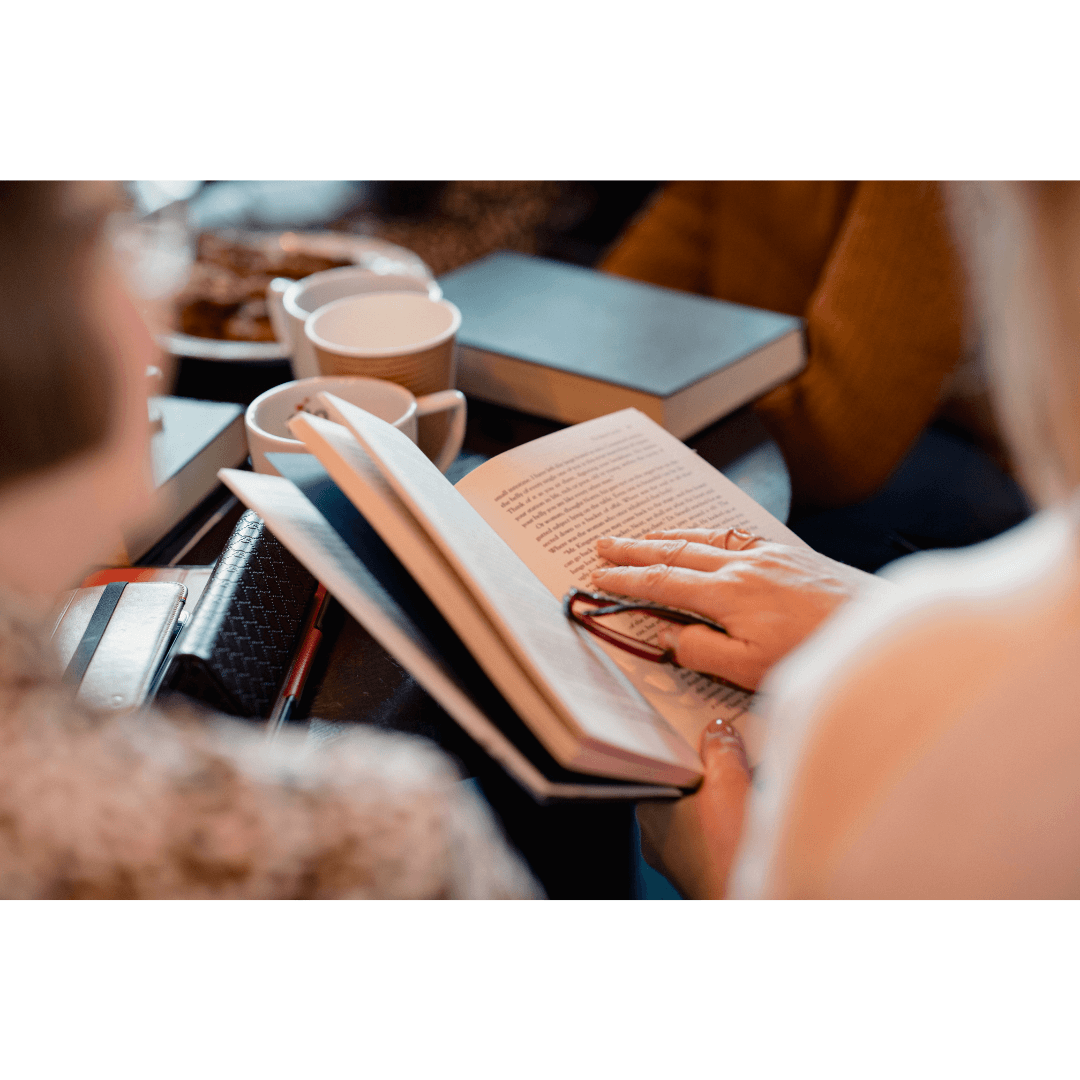
S’ouvrir à une nouvelle poésie pour plus de liberté
Ce qui fait encore de l’œuvre d’Arthur Rimbaud une poésie hors norme pour l’époque, au-delà du côté absolument révolutionnaire et la façon dont il traite son époque, c’est son style littéraire. En effet, dans une aire où l’écriture parnassienne domine le monde littéraire, il brise les règles. Même lorsqu’il vantera les codes du Parnasse dans l’espoir d’être publié, il s’en défait totalement dans le contenu.
En outre, il brise également la règle de l’uniformité poétique. D’après Jean-Baptiste Baronian, le recueil de Rimbaud participe à "démanteler et [à] désacraliser l’art d’écrire". Pour cela, il casse la règle d’unité de ton et propose des grossièretés, des marques d’oralité, de familiarité et d’argot. Il brise l’opposition entre la langue du poète très écrite et la voix du peuple, enrichissant ainsi la poésie de tout un discours qui n’y était pas encore admis.
Il propose ainsi au lecteur une œuvre polyphonique et désordonnée où chacun à son mot à dire. Mais ne nous y trompons pas, même si le soldat glorifie Napoléon III, même si le bourgeois fait entendre ses idées et ses balades, seule la voix du poète permet d’unifier le tout. Il s’en sert ainsi pour caricaturer, décrédibiliser, sensibiliser, défendre ou tourner en ridicule. Il mêle aussi les registres et le religieux à l’infâme (cf. "Vénus anadyomène"). Et si sa poésie dérange les biens pensants, c’est parce qu’il crée un nouveau langage poétique qui laisse entrer les mots (maux) du quotidien.

L’émancipation de Rimbaud en résumé
Émancipation familiale, politique, religieuse et sociale, Rimbaud brise tous les codes mais ne s’exile pas : il reste une figure du poète libre parmi son peuple. D’ailleurs, son émancipation ne fait pas de lui un homme apolitique, au contraire. Il se lève pour la défense des pauvres et tourne au ridicule les pauvres. Il le fait de manière outrancière et c’est en cela que l’écriture d’Arthur Rimbaud dénote. Il a à la fois le talent d’un jeune prodigue et la fougue révolutionnaire du jeune homme en recherche de liberté et de justesse.
Nous pourrions également rappeler que même pour sa famille, Arthur Rimbaud était particulièrement irrévérencieux. Sa sœur, Isabelle Rimbaud, tentera d’édulcorer les poésies de son frère qu’elle considère du point de vue religieux comme un péché, les présentant alors aussi comme des exercices scolaires. Même Paul Verlaine tente d’amoindrir la portée révolutionnaire des poèmes comme "Le forgeron" de son ami en le présentant comme l’œuvre d’un jeune garçon (immature, donc ?). Pourtant, la portée anticléricale, le républicanisme et le goût de la provocation de Rimbaud ne laissent aucun doute dans cette œuvre plus que les autres encore. N’oublions pas cependant, lorsque nous pensons à lui, qu’il a rejeté ces poèmes et qu’il a demandé qu’ils soient brûlés, sans que nous en sachions précisément les raisons. En effet, ses poèmes suivants seront plus aboutis, moins réalistes dans les images et ces premiers écrits montrent son monde intérieur, avant de devenir le voyant qu’il souhaitait être. Les Cahiers de Douai sont dès lors la première étape de son émancipation, celle qui lui permettra de devenir le "voyant" de ses futures œuvres. En effet, en mai 1871, Rimbaud rédige sa lettre du voyant et prouve qu’il atteint enfin son apogée littéraire :
Je dis qu’il faut être voyant, se faire voyant. Le Poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d’amour, de souffrance, de folie ; [...] il épuise en lui tous les poisons, pour n’en garder que les quintessences.
- la misère du peuple : "Les effarés", "le mal", "le forgeron" ;
- la bourgeoisie : "le forgeron", "roman", "A la musique" ;
- les soldats : "Quatre-vingt douze", "Rages des Césars", "La liberté revit !", "Le dormeur du Val", "Le mal"…